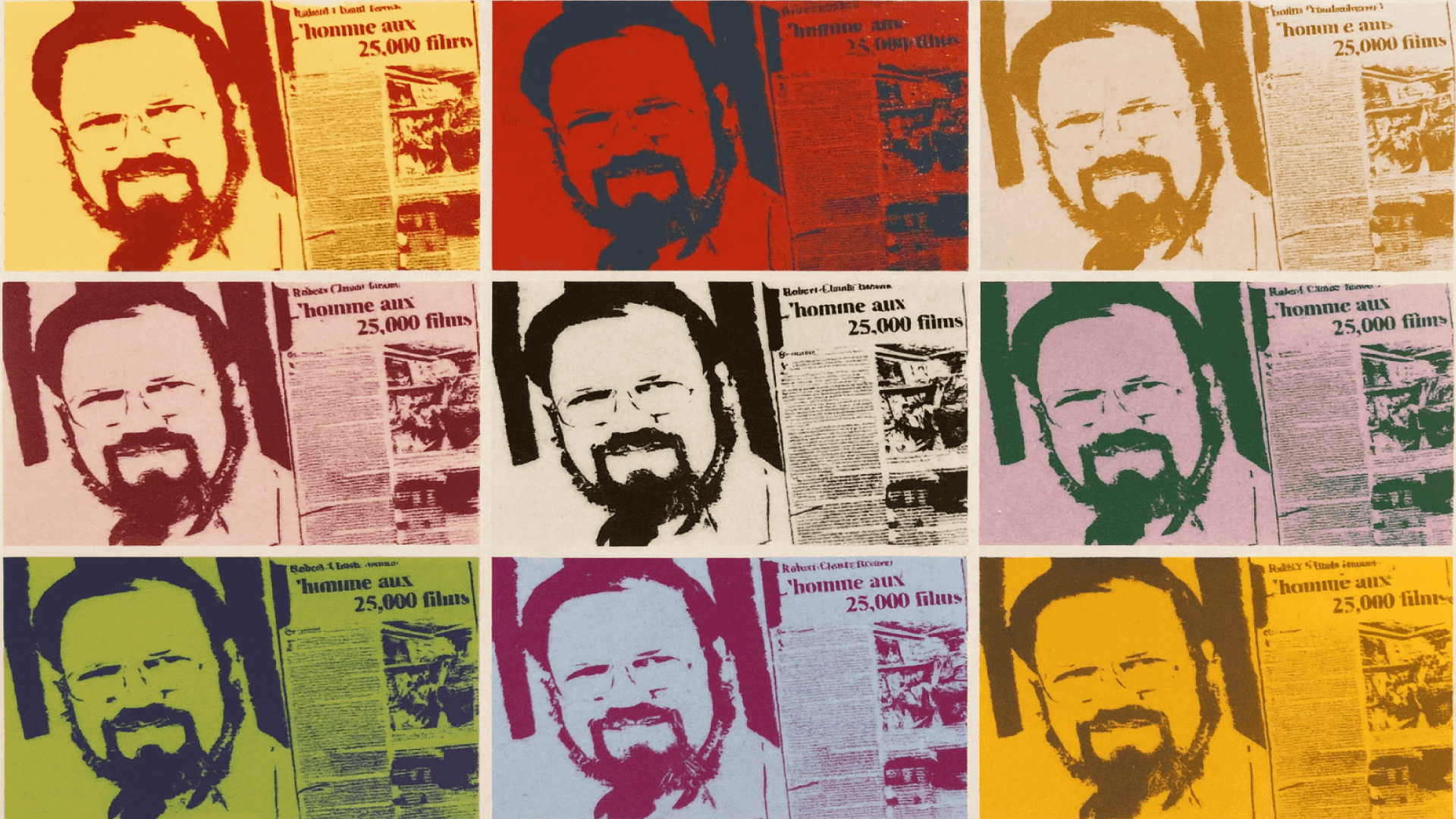Ce n’est pas l’auteure que j’ai le plus lue dans ma vie. Mais c’est celle qui a le plus façonné un idéal romantique pour de nombreuses générations de lecteurs et de lectrices. Ça fait 250 ans et elle est toujours là, alors qu’on n’a plus besoin de se marier pour survivre quand on est une femme. Et avec le personnage de M. Darcy, elle rend la personne la moins “bling bling” la plus intéressante. C’est comme ça que fonctionnent les grandes histoires d’amour au cinéma et dans la littérature : on apprend à voir autrement celui qu’on avait sous nos yeux.

Dans Jane Austen a gâché ma vie, son premier long métrage, à l’affiche le 23 mai, Laura Piani met en scène les errances affectives d’Agathe, une libraire parisienne et grande admiratrice de la célèbre romancière britannique, choisie pour participer à une résidence d’auteurs en Angleterre.
Avec un titre comme celui de votre film, on serait porté à croire que vous entretenez un rapport complexe avec Jane Austen.
Dans le film, le personnage d’Agathe est souvent perçue par les autres comme plus âgée. Il y aurait donc encore un préjugé de «la vieille fille» associé à Jane Austen.
Bien sûr. Tous les gens qui possèdent une âme tendre et sentimentale sont en permanence en train de justifier leurs goûts. C’est vieille-école, c’est ringard. Or, le romantisme est très politique. La manière dont on pose son regard sur l’amour en dit long sur une société. En même temps, je trouvais intéressant de rendre hommage à tous ces codes, sans faire un film à l’anglaise. Comme je suis Française, j’assume mon point de vue.
Visuellement, vous évoquez également l’univers de l’auteure : les jardins, la forêt…
Dans les codes de la comédie sentimentale, il y a les rendez-vous. Même le public, qui n’est pas forcément le plus aguerri, sait de quoi il s’agit. La balade dans le parc, c’est quelque chose qui apparaît dans chaque roman. [Austen] a inventé un genre. Avec la comédie sentimentale, l’enjeu n’est pas le suspense, mais la justesse des personnages et des sentiments dont on essaie de brosser le portrait.
Quelles étaient vos principales influences visuelles ?
Ma grande référence était Howards End de James Ivory. Pour la mélancolie. Le temps qui passe, les lieux qu’on quitte, le deuil, tout ça me bouleverse. C’était très clair que ça allait être la référence pour les scènes de repas de famille et la manière dont on allait filmer cette maison [où se déroule la résidence d’écriture]. Pour la librairie, c’était The Shop Around the Corner d’Ernst Lubitsch. En termes d’écriture et de rythme, il est l’un des plus grands. J’ai lu une citation de Billy Wilder à propos de Lubitsch qui disait : «il a fait plus avec des portes fermées que bien des réalisateurs avec des braguettes ouvertes.» Ça m’a guidée pour filmer le corps féminin et le désir, de manière un peu burlesque.
La grande question de When Harry Met Sally est également posée dans votre film à travers la relation d’Agathe et Félix : est-ce que l’amitié entre un homme et une femme est possible ?
C’est une question hyper importante. Je crois très fort à cette amitié homme-femme. En même temps, il faut se rendre à l’évidence : à chaque relation, la question se pose. Je trouvais intéressant que le personnage d’Agathe ait envie de prendre le risque de l’amour avec un ami qui la connaît par cœur. Pour elle, c’est très rassurant de ressentir un immense amour de la part de quelqu’un qu’on connait très bien. Mais dans le film, je raconte que ce n’est pas si simple.
Comment en êtes-vous venue à choisir Charlie Anson, qui interprète Oliver, l’équivalent de M. Darcy, un des personnages les plus iconiques de l’univers austenien?
Je cherchais un acteur Britannique qui puisse parler français. J’avais besoin que tous les comédiens puissent passer d’une langue à l’autre. C’était assez contraignant comme recherche. La directrice de casting m’a montré le profil de Charlie et j’ai tout de suite vu Hugh Grant. Bien sûr, à sa rencontre, j’ai constaté qu’il est beaucoup plus que ça. Il incarne aussi un lien direct avec les comédies anglaises des années 1990. Ça ancre le film. En même temps, il est beaucoup plus tendre, beaucoup plus doux et plus fragile. J’avais besoin de créer un personnage d’homme fêlé, cabossé, qui n’a rien du mâle alpha.
Selon vous, qu’est-ce qui fait que Jane Austen réussit à rester moderne ?
Elle est drôle et elle a une manière très particulière de raconter les tourments des femmes d’un certain âge. Dans Persuasion, par exemple, elle se demande ce que ça signifie d'éprouver le sentiment d’avoir raté sa vie. À quel âge peut-on déclarer que l’on est passé à côté de sa vie ? À l’époque, c’était 25 ans. Est-ce que maintenant c’est 40, 60 ou 70 ans ? C’est ce que je trouve hyper beau : il y a toujours de l’espoir pour ses personnages. Il y a une tendresse infinie et un truc radical : le snobisme, les artifices et les questionnements superficiels sont ridiculisés. Et ça, ça fait un bien fou !
Crédit photo : Marie Rouge