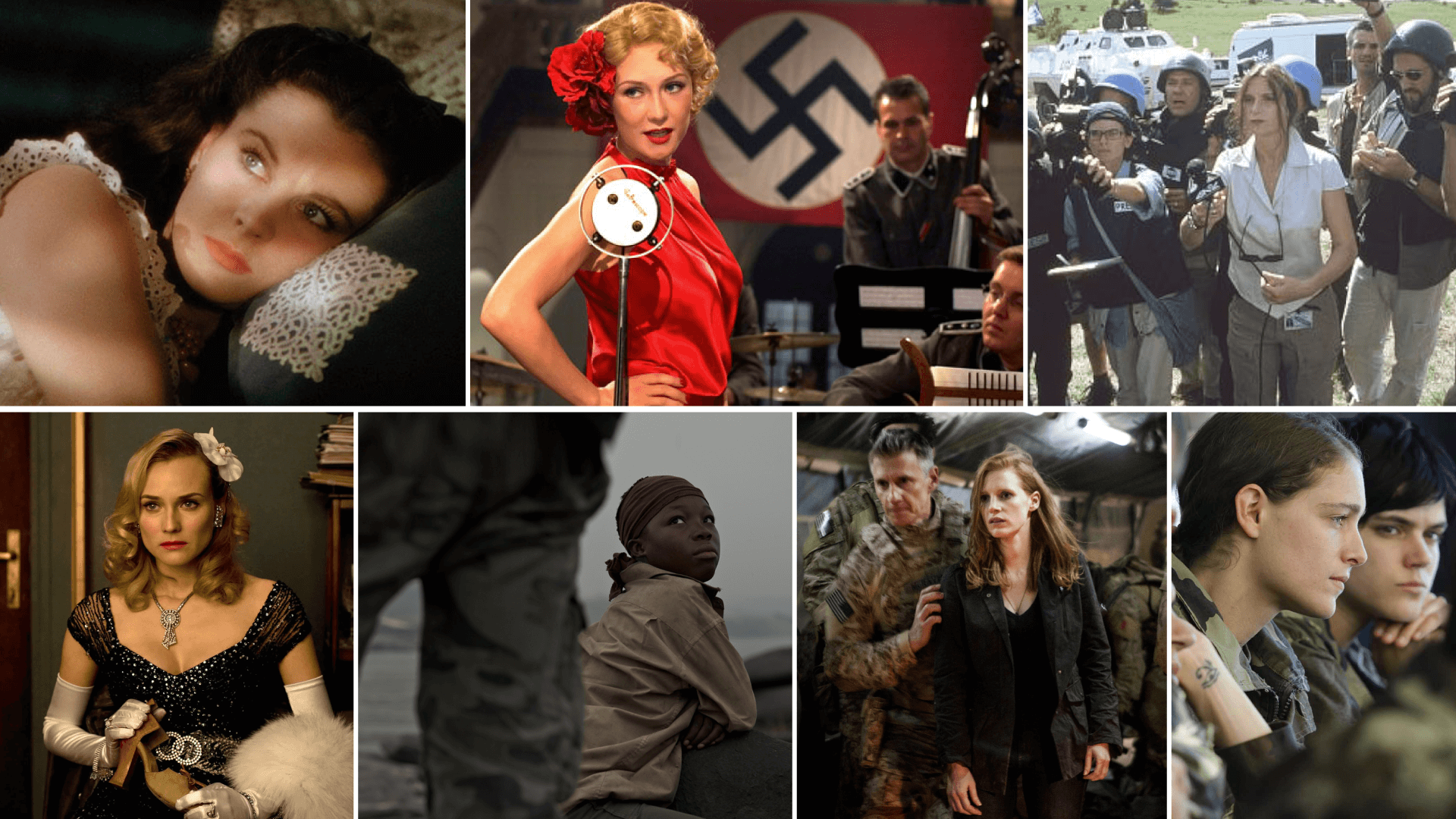Au départ, on désirait puiser dans les scènes marquantes de la vie de cette personne, que notre producteur Serge Noël nous a fait rencontrer, afin de créer une banque de segments qu’on scénariserait. Mais ce qui s’est imposé à nous a été de réinventer et créer un personnage ainsi qu’un univers fictif, celui d’Halima avec, peut-être, une partie du drame qu’on voulait conserver. Ce que j’ai souvent utilisé, ce sont les impressions, les sensations et les émotions que cette personne a ressenties.

Huit ans après Montréal la Blanche, Bachir Bensaddek réalise La femme cachée, émouvant récit d’une Québécoise d’origine algérienne confrontée à son passé. Entrevue avec un réalisateur attentif et bienveillant.
La femme cachée est inspiré d’une histoire vraie. Quel a été le processus avec la scénariste Maria Camila Arias pour fictionnaliser le récit ?
Bien qu’il s’agisse d’un voyage intérieur, le parcours d’Halima prend des allures d’enquête.
C’est un voyage au bout d’elle-même. Avec Maria, on voulait incarner le parcours d’Halima vers son passé par un périple en France, mais aussi par la découverte d’indices. On avait besoin d’une tension menée par l’enquête de quelqu’un qui n’est pas tout à fait certaine de ce qu’elle cherche. Elle a l’impression que ce qu’elle trouve au bout de sa quête va lui permettre d’aller mieux. Où va-t-elle trouver des réponses ? Sa famille ? La fratrie ? Halima ne dit pas tout. Elle dissimule des choses et s’en cache à elle-même.
Quelle posture souhaitiez-vous avoir à la réalisation pour aborder un sujet comme celui-ci ?
Ça demande de l’écoute à l’égard des personnages afin de pouvoir demeurer crédible et générer de l’empathie. Ça exige également de l’humilité, car en se lançant dans quelque chose d’un peu périlleux, on est dans une zone où les règles qui prévalent au sein d’une famille - et de la société - sont bafouées et transgressées. [...] C’est la manière dont j’aime travailler. Depuis mon premier projet documentaire, il y a 25 ans, j’écoute les gens et j’entend les sensations.
À l’image, vous jouez beaucoup avec les couleurs chaudes et la lumière. Qu’est-ce qui a mené vers ce choix stylistique ?
Ce film est tellement dur qu’on ne pouvait pas aller vers le froid visuellement. Il fallait quelque chose qui contraste avec cette histoire. J’avais envie d’ouvrir l’image pour que les gens puissent se retrouver dans cet univers au sein duquel les décisions des personnages peuvent être parfois déroutantes. Je voulais éviter le ton du drame social auquel on s’attend souvent avec les récits d’immigration. Je souhaitais mettre en scène une tragédie et quelque chose de cinématographiquement plus spectaculaire.
Comment êtes-vous tombé sur Nailia Harzoune pour interpréter Halima ?
Plusieurs noms m’ont été proposés. Lorsque j’étais en repérage à Montpellier, en France, une agente parisienne et une directrice de casting m’ont toutes les deux écrit pour me suggérer Nailia Harzoune, à quelques heures d’intervalle. Je l’avais vue dans Patients de Grand Corps Malade. Je n’avais jamais imaginé qu’elle pouvait interpréter la mère d’une fillette de 6 ans, partie de chez elle il y a une quinzaine d’années. On lui a envoyé le scénario, on s’est parlé et ce fut un coup de foudre professionnel.
Et pourquoi vous-êtes vous tourné vers Antoine Bertrand pour jouer Sylvain ? Il est ici sollicité dans un registre plus dramatique.
Sylvain, c’est un homme qu’Halima s’est choisi pour réinventer sa vie. Ça lui prend alors quelqu’un qui l’enveloppe, qui lui amène tout ce qu’elle n’a pas eu dans sa jeunesse : de la douceur, du confort, de la bienveillance et un peu de légèreté. Antoine représente tellement de choses dans notre inconscient collectif québécois. On l’a vu grandir à l’écran, de jeune homme dans une famille dysfonctionnelle à l’homme le plus fort du monde. Il est l’addition de toutes ces facettes.
À la fin du film, Halima dit à Sylvain et à sa fille «on rentre à la maison». Cette notion du «chez soi» est finalement au cœur du film.
Pour qu’elle se sente chez elle, Halima doit régler tout ce qu’elle a laissé en suspens. Rentrer à la maison signifie refermer toutes les portes derrière elle. Les immigrants arrivent chez nous avec la valise à moitié fermée. Il y a des petits bouts de vêtements qui dépassent, car il a fallu fermer ça rapidement. Si on ne règle pas les problèmes dont on pensait s’être débarrassé, ils finissent par ressortir. C’est souvent le cas de personnages qui ont besoin de régler un passé douloureux avec lequel ils n’ont pas réussi à faire la paix. Rentrer chez soi, c’est avoir la possibilité de dire que chez soi, c’est nulle part ailleurs.